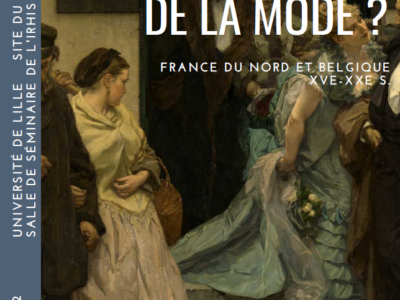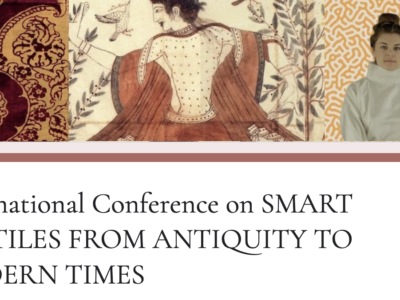À propos
Journées d’étude de l’AFET 2025
Château de Fontainebleau
21 – 22 novembre 2025
Moment particulier de la journée, la nuit est le temps du repos, du repli sur soi, mais aussi celui de l’insomnie, du rêve et des cauchemars, d’activités spécifiques, comme le travail ou la fête… Elle peut être également synonyme d’ombre, d’obscurité, de néant, parfois de mort. La nuit est aussi porteuse d’un imaginaire fantastique, d’une symbolique et l’occasion de rites spécifiques. Examiné sur la longue durée et au sein d’un vaste espace géographique, ce thème permettra d’appréhender les dimensions suivantes :
– La nuit perçue comme un temps/espace/territoire d’activités spécifiques (dormir, danser, cambrioler, etc.) qui impliquent le port, la fabrication de textiles et d’habits ou confections conçus pour les occupations nocturnes, tels que les vêtements de sommeil et de « dorveille », les textiles du couchage mais aussi les habits de fête ou ceux des ombres (créatures rêvées, cambrioleurs…). À travers des études d’œuvres, des enquêtes ethnologiques ou historiques, ce thème développera ce que les textiles révèlent du rapport que les sociétés entretiennent avec la nuit et leurs pratiques nocturnes paisibles, festives ou illicites.
– La nuit comme un monde en soi, tout particulièrement avant l’arrivée de l’électricité ou en l’absence de lumière, c’est-à-dire à la fois un univers inquiétant, source de peurs et de dangers, mais aussi une dimension onirique et spirituelle. La dimension contraignante de la nuit permettra d’évoquer la manière dont des créateurs, ingénieurs, inventeurs, fabricants ont déjoué l’absence de lumière ou joué avec celle-ci afin de récréer l’éclat dans l’obscurité par la création de textiles adaptés à la vision nocturne, tels que les tissus réfléchissants, phosphorescents et lumineux, mais aussi ceux qui jouent avec l’obscurité entrecoupée des éclairs stroboscopiques. L’approche plus métaphysique conduira à aborder notamment l’iconographie de la nuit dans le textile. À la croisée de l’histoire des techniques, des représentations et des sensibilités, cette dimension invitera aussi à réfléchir à l’impact de l’invention de l’électricité sur la création textile.
– La nuit comme espace de création textile, c’est-à-dire comme une condition spécifique. Dans les centres urbains, au Moyen Âge et durant l’époque moderne, les communautés des métiers du textile ont entretenu un rapport ambigu avec la nuit, certaines corporations proscrivant le travail de nuit tandis que d’autres s’y astreignent pour répondre aux commandes et ainsi dilater le temps nécessaire aux réalisations. De nos jours, des usines imposent le travail de nuit afin de ne pas arrêter les machines. Cette partie inviterait à examiner les conditions du travail de nuit sur la longue durée (salaires, systèmes d’éclairage), ses conséquences sur la santé des populations artisanales et ouvrières (à partir d’enquêtes) et ses motivations en prenant en compte une grande diversité de contextes (usines, travail à domicile, ateliers urbains etc.).
– La nuit comme alliée du textile. Cet aspect soulignera comment l’absence de lumière répond aux exigences de préservation des tissus et comment ce facteur influe sur les politiques muséales, la scénographie, la perception des visiteurs, etc. En contrepoint, la question des textiles archéologiques permettrait de souligner l’ambiguïté de l’exhumation, c’est-à-dire faire sortir de l’obscurité des objets qui entrent alors dans un autre cycle de dégradation au profit de la connaissance.


Plusieurs types d’interventions d’une durée de 20 minutes peuvent être acceptés :
– communications orales avec présentation d’illustrations,
– témoignages,
– interviews, etc.
Les propositions sont à envoyer à Isabelle Bédat (bedat.isabelle@wanadoo.fr) le 20 mai 2025 au plus tard. Une notification d’acceptation ou de refus vous parviendra au plus tard le 20 juin suivant.
Ces propositions comprendront :
– Nom de l’auteur, Institution / Organisme
– Titre de la proposition
– Résumé de 15 lignes environ
Le comité scientifique pourra réduire à 10 minutes le temps de communication si nécessaire. Comité de sélection :
– Sandrine Bachelier
– Claire Berthommier
– Astrid Castres
– Vincent Cochet