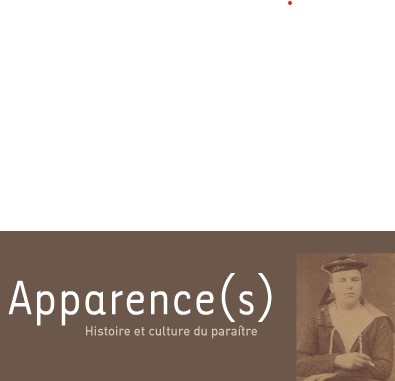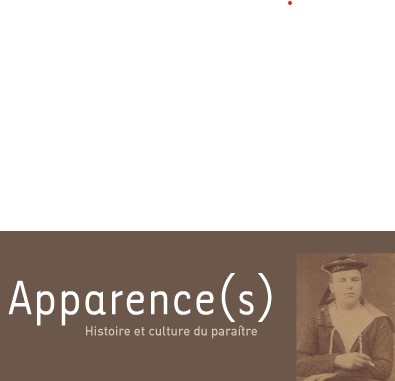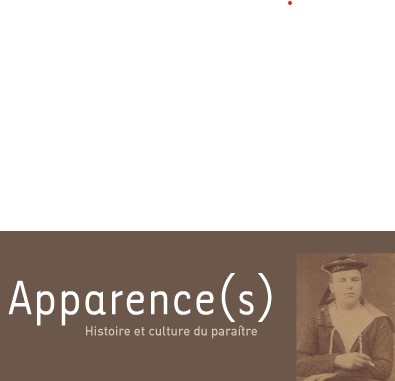La revue Apparence(s) consacre son prochain numéro (parution printemps 2021) à l’étude des rapports complexes de la mode, du vêtement et des apparences aux animaux et matières animales à travers l’histoire. Le numéro entend explorer tant l’utilisation des matières animales – depuis la fourrure et les plumes jusqu’aux cochenilles ou à la soie — que l’inspiration qu’ont fourni au vêtement les animaux en termes de formes et de motifs – depuis les premiers tissus léopard au XVIIIe siècle (voire antérieurement) ou la mode girafe en France dans les années 1830s jusqu’à la combinaison ‘peau de requin’ du nageur Michael Phelps. Il s’agit d’étudier les pratiques vestimentaires et leurs significations ainsi que leur impact – qu’il soit culturel, économique ou environnemental. Le volume se propose d’étudier l’utilisation de matériaux animaux dans les pratiques vestimentaires mais aussi d´élargir le champ aux métiers et savoir-faire qui restent souvent dans l´ombre comme ceux du plumassier, du tanneur, du chapelier, du fourreur, du coupeur de fanons, etc. en insistant sur les dimensions aussi bien esthétiques, sociales et économiques de ces savoirs faire que sur leurs relations avec des enjeux technologiques et environnementaux plus largement.
Tout à la fois source d’inspiration de créateurs de mode contemporains que moteur historique de la puissance économique des nations, ou référence spirituelle des civilisations (on pense par exemple aux manteaux de plume rituels des cultures océaniennes) ou champ de recherche des biotechnologies contemporaines (fibres dérivées de l’ADN de l’araignée ou du lait de chèvre), le vêtement – de mode, quotidien, technique ou rituel – entretient depuis toujours des relations complexes avec le règne animal.
Signes distinctifs de la civilisation humaine, interfaces entre corps politique et corps individuel, le vêtement et la parure corporelle sont des lieux privilégiés où se tissent et se mettent en scène les rapports entre l’humain et l’animal, et au monde naturel en général.
Pourtant, à part quelques études isolées, peu de travaux se sont intéressées aux rapports du vêtement et des apparences au monde animal. Lorsque ces questions ont été étudiées, elles l’ont été sans toujours que la chronologie, la géographie ou l’approche méthodologique de l’étude ne permettent une appréhension plus globale des phénomènes étudiés.
Au carrefour de nombreuses disciplines et se situant sur la longue durée et sans restriction géographique ou culturelle, le numéro « Modes Animales » entend explorer les relations complexes entre vêtement et animaux en faisant dialoguer spécialistes de la mode, historiens du vêtement, anthropologues, archéozoologues, ou spécialistes de biologie animale.
Dans ce numéro, nous voulons aussi nous interroger sur l’apport des animal studies pour l’étude des liens entre mode et produits animaux. En effet, le champ des animal studies, en partant de la prémisse que les animaux ont leur propre « agency », tend à déconstruire ou remettre en question le dualisme cartésien qui structure traditionnellement les approches scientifiques et oppose l’homme vu comme sujet actif et l’animal vu comme objet passif.
Nous invitons historiens, économistes, historiens de la mode et du vêtement, archéologues, zoologues, anthropologues ou spécialistes des animal studies à envoyer leur proposition à afennetaux[at]yahoo.com et gabriele.mentges[at]tudortmund.de
Les articles, rédigés en français ou en anglais, de 40 000 à 50 000 signes environ et accompagnés d’un résumé de 1000 signes (espaces comprises) et de 5 mots clés dans les deux langues, devront être envoyés aux éditrices avant le 30 octobre 2020 . Merci de se reporter aux indications données sur le site de la revue pour les normes typographiques.
Les articles reçus seront soumis à un processus de double évaluation à l’aveugle, merci de bien vouloir respecter le format d’envoi ci-dessous :
Les envois devront prendre la forme suivante :
Un document WORD (en times 12 interligne doubleà qui ne porte pas le nom de l’auteur où se trouve l’article et ses notes, les légendes complètes des illustrations éventuelles, un résumé de 1000 signes et 5 mots clés
Une fiche de renseignement où figurent le nom de l’auteur, son affiliation professionnelle, ses coordonnées et une notice biographique de 1000 signes environ
Un dossier contenant les fichiers images en format jpg ou tiff dans lequel les fichiers seront nommés de la manière suivante
VotreNomFig1.jpg/.tiff
VotreNomFig2.jpg/.tiff